La librairie indépendante est un des piliers de notre exception culturelle. Mais sa fétichisation, par les milieux bourgeois et par une grande partie de la gauche, dissimule la souffrance de ses travailleurs : stagiaires exploités, salariés pauvres et précarisés, isolement et violence sociale… Derrière l’image d’Épinal véhiculée par les patrons et leur syndicat (SLF – Syndicat de la Librairie Française) se dissimule un véritable champs de ruines social.
Librairie indé : le mur de la réalité
Le jour de mes 30 ans, j’ai signé dans une librairie indé. Sortant de périodes de chômage, de RSA et de CDD en grandes surfaces culturelles, signer dans une librairie indé réputée « de gauche », c’était un peu un rêve : la promesse de ne plus empiler du Zemmour en tête de gondole, promesse d’un rapport plus humain avec la clientèle et d’une approche plus engagée au livre et à la culture.
Bon, j’étais naïf : la réputation de gauche de ladite librairie était héritée des précédents propriétaires, mais plus du tout incarnée ; et si le Z m’a été épargné (être responsable du rayon a probablement joué un rôle), il n’est pas facile de crédibiliser un tout nouveau rayon féminisme quand le patron passe une part non négligeable de son temps à poster des blagues et commentaires sexistes entre deux éloges du dernier Houellebecq (ce qui fut l’objet de plusieurs plaintes de client·es royalement ignorées). Passé le déni des premières semaines, la désillusion était forte, et le malaise n’a fait que grandir.
La suite a été une descente aux enfers. Précarisé à 28h/semaine au smic dans un CDI que je n’ai jamais eu l’occasion de signer (malgré mes nombreuses demandes), je vivais sous le seuil de pauvreté, je prenais peu de congés (on ne m’y a jamais encouragé), je me retrouvais de plus en plus seul en magasin, à devoir accepter de plus en plus de charge (j’étais responsable de plusieurs rayons, je gérais la communication, les réseaux sociaux, j’ai même réalisé leur logo). Je soulevais parfois jusqu’à plus d’une demi-tonne de cartons de livres par semaine, ce qui m’a occasionné des douleurs insupportables aux genoux et au dos (j’ai appris que si je n’avais pas levé le pied, décision qui s’est retrouvé plus tard en motif de licenciement sous l’expression « démotivation », je serai possiblement devenu handicapé), je ne comptais pas mes heures, j’ai fait du zèle par « engagement » et « passion », tout en pleurant tous les soirs d’épuisement et de mal-être. J’ai même renoncé à un arrêt médical parce que je savais que la situation serait pire si je les « lâchais » pendant les fêtes. J’ai été broyé, isolé, accusé de tous les maux pour justifier mon départ, abandonné par une clientèle qui aime se croire de gauche mais échoue à pratiquer ce qu’elle lit et ce qu’elle prêche.
La vérité, c’est que comme de nombreux libraires, je me suis fait avoir par une promesse creuse, l’indépendance, et par le fossé qui sépare ce qu’on y projette de ce qu’elle cache beaucoup trop souvent.
Le vrai coût de l’indépendance
Dès le premier jour où j’ai évoqué mes conditions de travail sur les réseaux sociaux, j’ai reçu des messages. Ex-libraires, travailleurs précaires épuisés, muselés, stagiaires exploités, travailleurs aux corps abîmés au point parfois d’avoir aujourd’hui un handicap. Et si je ne nie pas qu’il existe de la souffrance au travail en dehors de la librairie indépendante, toustes témoignaient de leur désillusion, voire de leur dégoût pour un secteur présenté comme plus humain, engagé et solidaire, et qui s’avère souvent être le contraire.
Parce que la librairie indé, véritable miroir aux illusions, ne fonctionne bien souvent que grâce à l’exploitation de travailleurs précaires (rarement en CDI), de stagiaires (rarement rémunérés et souvent mineurs), voire par l’exploitation du travail gratuit de clients, amis, famille…Un « constat amer » que me partage Max (les prénoms ont été modifiés) par message : « je bosse dans une librairie où il y a un turn-over très important. On a des périodes d’activités assez importantes où la boutique ne fonctionne que grâce à « l’embauche » de très jeunes professionnels du milieu, stagiaires, voire du tout venant. » De gauche l’indépendance ? Engagée l’indépendance ?
Max me décrit une situation que j’ai lu des dizaines de fois : très peu de CDD transformés en CDI, salariés constamment dans l’incertitude « sur des périodes qui durent parfois de longs mois. » Les conséquences d’un tel fonctionnement sont inévitables : « ça pèse aussi forcément sur les personnes déjà en poste qui passent leur temps à former sur le tas et à la va-vite des gens qui dans tous les cas ne restent pas. » Le pire, souvent, c’est le discours des patrons qui, comme dans ce cas, assument de pousser les gens à partir parce qu’ils « n’ont pas les moyens de faire évoluer les salaires ».
La toxicité de l’environnement de travail en librairie indé est aussi à regarder de plus près. Un salarié en librairie indé va souvent être seul ou au sein d’une équipe restreinte, dans un climat de fausse proximité avec ses patrons qui favorise l’exploitation, et en l’absence d’interlocuteurs (pas de syndicat, pas de représentants du personnel, pas de CE, rien, nada), favorise également le harcèlement. Alice, embauchée en CDI pour remplacer une salariée qui s’en va « pour des problèmes de santé », en témoigne : « Tout le monde critiquait cette fille que j’allais remplacer, mais c’était pas cette fille le problème, ça je l’ai découvert trop tard. » Alice décrit un climat oppressant et irrespirable : « Ça s’est très mal passé avec la patronne. Non seulement je vivais chez elle, mais en plus elle était sur mon dos constamment, je faisais erreurs sur erreurs, j’étais en stress permanent. »
Finalement, elle est mise à la porte, mais trop tôt, donc sans chômage, sans logement, et doit compter sur la solidarité d’une amie pour être hébergée. Elle aussi fait le constat amer d’un élitisme et d’une « culture du mépris » au sein de la librairie indé qui justifierait tous les écarts : « j’ai beaucoup appris de cette expérience, notamment que les droits des salariés ne sont pas respectés, que tout le monde se laisse faire parce que c’est l’élite. (…) dans ce milieu tout le monde la boucle ». Elle termine en répondant à ma décision de quitter le métier de libraire : « Tu n’es pas seul, bon nombre de personnes ne travaillent plus dans ce milieu à cause de ce genre de patrons. » Et de fait, de mon DUT dédié aux métiers du livre, dix ans après, je peux compter les libraires sur les doigts d’une seule main.
Exploiter ou souffrir, le choix des indés
Les causes du mal ne sont pas seulement les petits patrons incompétents, mal ou peu formés, en reconversion « passion » après des années dans une banque, une compagnie d’assurance ou une agence immobilière. Les causes sont avant tout structurelles. L’éléphant au milieu de la pièce que tout le monde regarde sans se dire qu’il est problématique, c’est que la librairie indé n’est pas rentable. En effet, la marge nette d’une librairie est environ de 1% (c’est très très faible). Et si les patrons des librairies indé sont aussi maltraitants, c’est peut-être aussi qu’ils acceptent, au nom d’une passion, une souffrance au travail qui serait « un mal nécessaire ». Une souffrance, qu’ils choisissent d’endurer, mais aussi d’infliger à leurs salariés et à leurs stagiaires.
C’est ce que me témoigne Carole, qui me raconte avoir voulu ouvrir une librairie. « J’ai essayé de dresser un plan financier qui tienne la route. J’engageais une personne à mi-temps dans celui-ci parce que je ne voulais pas me retrouver à gérer tout toute seule, et du coup j’avais prévu un salaire décent pour cette personne. Résultat des courses, je ne pouvais pas me payer correctement, ni la première année, ni celles d’après. » Une situation partagée par de nombreux petits libraires, qui ouvrent sans pouvoir se payer pendant parfois plusieurs années (ce qui soulève aussi une question : qui peut se le permettre ?). Elle raconte en avoir discuté avec des libraires, « pour avoir un peu d’aide et de soutien pour ce projet (je pensais naïvement qu’avec le monde qui arrive, les libraires seraient solidaires). Je n’ai rencontré quasi que des gens drapés dans un truc de ‘c’est de la souffrance d’être libraire et c’est pas pour tout le monde mais moi je tuerais pour le rester’ ».
Une phrase qui fera réfléchir Carole. Au nom de quoi devrait-on accepter de ne pas être payé ? « Comment se peut-il d’investir de l’argent et du temps pour monter un truc sans pouvoir en vivre ? Comment est-ce normal qu’une librairie ne puisse être viable qu’en appauvrissant ses travailleurs ? » C’est donc ça, le choix des indés ? Exploiter ou se tuer à la tache ? Mourir pour la cause ou déléguer une partie de sa souffrance à un travailleur précarisé (dans le meilleur des cas) ? C’est d’ailleurs le sens de l’aveu hallucinant qui lui est fait : « Mais tu verras, les stagiaires c’est la vie si tu tombes sur un bon tu peux lui demander plein de trucs. » C’est inimaginable pour elle : « Je ne suis pas d’accord. Un·e stagiaire que je ne paie pas ou peu ne peut avoir la même responsabilité qu’un·e employé·e. » Ce constat sonne la fin de son projet : « J’ai été dégoûté et j’ai décidé que je ferai autre chose de mon amour des livres. (…) je refuse d’ouvrir une librairie si c’est pour exploiter des gens ou me niquer la santé, et je trouve dommage que ça semble être les deux seules possibilités… »
Et pourquoi ? Pourquoi le métier de libraire est à ce point vu comme une vocation, une mission culturelle, une passion pour laquelle il serait normal de sacrifier sa santé physique, mentale, sa vie de famille et sa vie sociale ? Vu d’ici, on ne semble pas si loin du syndrome de Stockholm : quand votre travail devient votre vie, quand vos clients deviennent vos amis, quand votre librairie devient quasiment votre maison, vous vous y accrochez de manière maladive parce que c’est tout ce qu’il vous reste de vie sociale et même parfois de vie de famille. Vous ravalez vos larmes, vous faites un grand sourire, et derrière ce masque insupportable, vous conseillerez à vos clients de lire Le syndrome du patron de gauche (Arthur Brault-Moreau, éditions Hors d’Atteinte), comme si ça allait compenser la souffrance subie, et infligée.
Aucune thérapie ne soigne l’injustice, l’action politique, si
Depuis mon licenciement, je suis en colère. Régulièrement, on me conseille d’aller voir un psy. Comme si une pilule quotidienne et une bonne thérapie pouvait soigner l’injustice et la précarité. Cette injonction à regarder en nous plutôt qu’à dénoncer la violence sociale et l’injustice vient souvent de gens qui ne les connaissent pas. Cette injonction est bienveillante, assénée avec un sourire compatissant, ce sourire de pitié que le bourgeois offre au pauvre pour lui montrer qu’il ne fera rien, mais qu’il est humain. Alors aux anciens clients qui tomberaient ici bien par hasard : non, je ne vais pas me calmer. Parce que contrairement à vous, et même à ceux d’entre vous qui affichent leur engagement comme une identité, je préférerai toujours l’action politique aux paroles creuses. Je n’ai pas peur de brûler les ponts qui nous séparent parce que je sais que je me trouve du bon côté : celui de ceux qui souffrent au travail, asservi par un système que vous défendez tout en prétendant le combattre.
Et si, au lieu de se calmer, on changeait la librairie ? Et si le modèle tellement romantisé d’une librairie à soi était plus le reflet des illusions individualistes du capitalisme que la possibilité d’une alternative ? L’indépendance ne veut pas dire grand chose si les deux piliers qui la soutiennent sont la précarité et la violence sociale. La romantisation de « ma p’tite librairie » a souvent la saveur douce-amère du Montmartre jaune sépia d’Amélie Poulain. On aimerait y croire, à ce filtre un peu kitsch, mais à y regarder de plus près, ce qu’on aime nommer « refuge » ou « cocon » est en vérité un enfer de solitude. On ne peut construire l’alternative seul, mais une librairie s’ouvre rarement à deux : s’il est déjà difficile, même au bout d’un an, de se dégager un seul salaire, imaginer en sortir deux est un pari risqué.
Alors quoi, on abandonne ? Ou on essaye autrement ? On imagine d’autres lieux de vie, ouverts, un espace café, une fripe solidaire, un lieu associatif, un tiers lieu autogéré dans lequel la librairie serait intégrée ? Penser que dans un monde qui cherche à nous isoler, la réponse doit être, plus que jamais, le collectif et la solidarité.
C’est ce qui me vient à l’idée quand Marie me parle du conflit qui sépare les patrons de la librairie dans laquelle elle travaille, et le reste de l’équipe, soudée et solidaire. Elle explique qu’elle est arrivée au moment où deux libraires de l’équipe reprenait l’affaire aux anciens patrons : « je les ai vu changer peu à peu, passant d’anciens collègues très conscients de ce que c’est d’être en magasin, à des patrons assez fermés et incapables de se remettre en question. Plusieurs collègues sont partis suite à des situations très problématiques, qu’on appellerait probablement harcèlement si un syndicat se penchait dessus… et deux personnes – bientôt une troisième – en burn out… Alors qu’il y a dix ans, c’était le paradis des libraires ! »
Tout y est : la hiérarchie qui corrompt et paralyse, des salariés rabaissés, isolés, réduits au départ ou au silence, mais aussi leur réelle solidarité. Est-ce qu’une gouvernance collective, par les salariés eux-mêmes, ne serait pas plus éthique et efficace ? En finir avec le complexe du patron incompétent et ses décisions hors sol et absurdes. Que les salariés possèdent enfin leur outil de travail, pour en finir avec le sentiment de dépossession injuste que l’on peut ressentir quand on nous pousse dehors : le sentiment que le travail accompli n’a aucune valeur, que ce qu’on laisse derrière nous nous aura été volé, sentiment d’avoir été exploité, essoré, puis jeté comme une éponge aux ordures.
Cette souffrance, nous sommes nombreux•ses à l’avoir vécue. La souffrance, au nom de l’indépendance. La précarité, au nom de l’indépendance. La violence, au nom de l’indépendance. La santé ravagée, au nom de l’indépendance. Combien de temps laisserons-nous ce champs de ruines être dissimulé derrière l’image d’Épinal de la librairie indé ? Combien de temps allons-nous laisser ces gens confisquer l’alternative pour y faire perdurer les illusions capitalistes et la violence qu’elles génèrent ? Combien de temps allez-vous fermer les yeux sur notre souffrance, pour ensuite défiler le 1er mai au nom de la justice sociale ?
Combien de temps, avant que tout crame ?
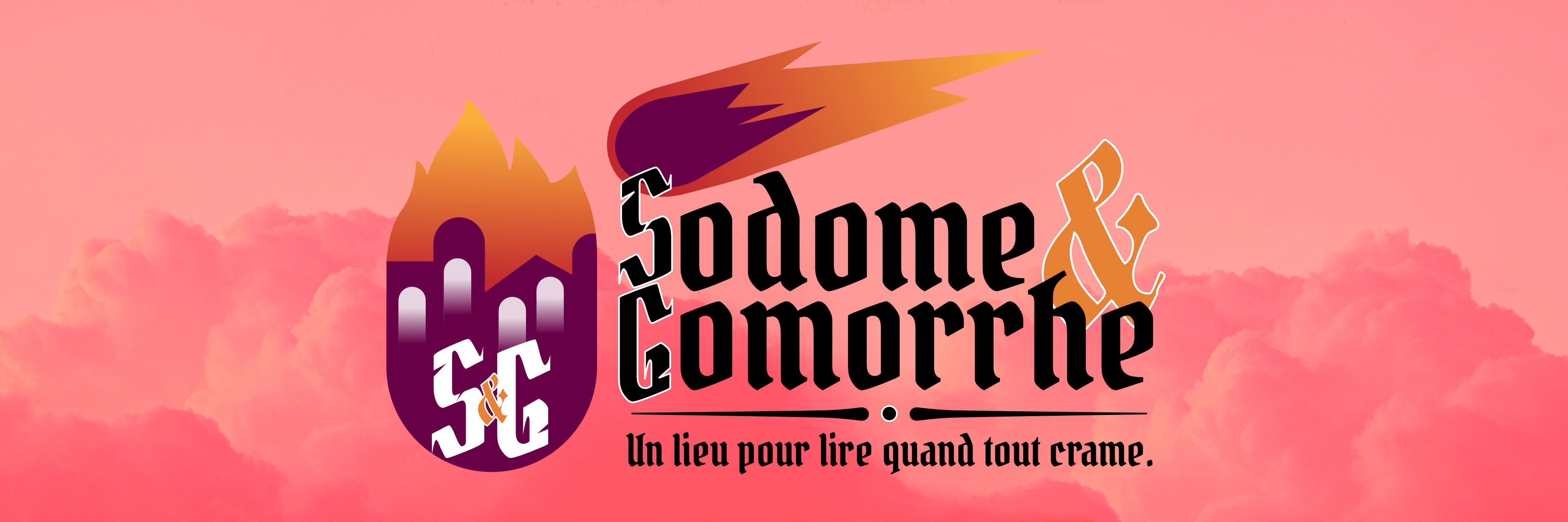
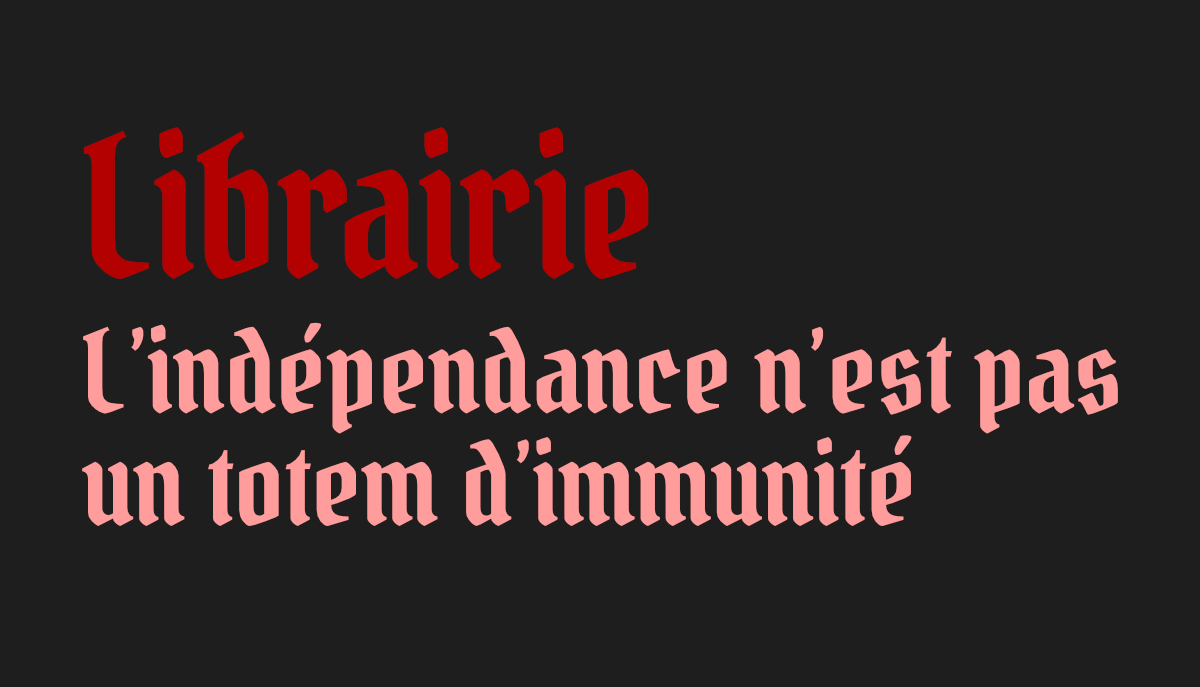
Laissez un commentaire